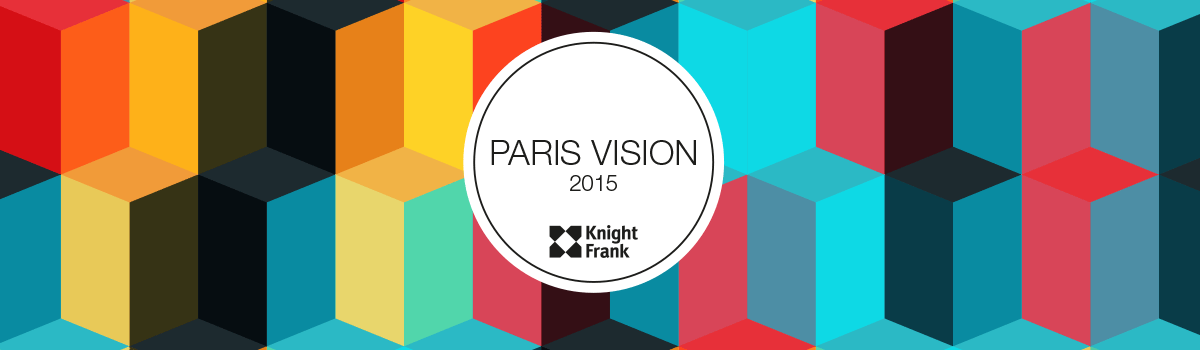Wednesday 18 February 2015
Grand Témoin : Marc-Antoine Jamet
Knight Frank : Dans un environnement économique mondial qui reste incertain, comment se porte le luxe aujourd’hui ?
Marc-Antoine Jamet : Le marché des produits de luxe ne peut être totalement indépendant de celui des autres biens et services. Comme ceux-ci, il préfère la croissance au marasme, la paix aux conflits, la confiance à la crainte. Mais, outre que ses déterminants psychologiques relèvent de mécanismes plus intimes et plus originaux que ceux qui président à l’achat d’objets « ordinaires », ne serait-ce que par les sentiments qui l’entourent, le désir d’éternité qui l’accompagne, la quête d’excellence et de perfection qui le caractérise, les rythmes économiques qui régissent le secteur du luxe lui sont particuliers. Particuliers et diversifiés, car sa bonne santé ne tient pas seulement au fait qu’il est associé au voyage, au plaisir, à l’estime de soi, aux grands moments, au versant positif de la vie. Un secteur créateur d’emplois, de croissance industrielle, d’excédents commerciaux, sans même aborder la question des importantes recettes fiscales qu’il procure aux États, ne pourrait se fonder uniquement sur cette recette.
Si on observe le Groupe LVMH, il dispose, notamment dans les périodes difficiles, de puissants stabilisateurs qui se transforment rapidement en multiplicateurs, en accélérateurs de développement. D’abord, il s’appuie sur un rassemblement inégalé de 70 marques. Elles ont toutes leur univers, leur ressort, leur légende, leur dynamique. Elles conservent ainsi leurs aficionados et en attirent de nouveaux. Elles créent avec eux, par les vertus de la distribution sélective, quand elle n’est pas exclusive, un lien à nul autre pareil. Ces qualités qu’on pourrait nommer, souplesse, adaptabilité et réactivité, ne sont pas toujours le propre d’autres secteurs moins prestigieux ou plus massifs. En cela repose la première originalité du secteur et singulièrement de l’entreprise que je sers. Elle peut aussi compter sur une répartition équilibrée entre plusieurs métiers, les plus importants étant la mode et la maroquinerie, les parfums et les cosmétiques, les vins et les spiritueux, l’horlogerie et la bijouterie, mais également l’armement de yachts, l’édition ou l’hôtellerie d’exception. Chacun des secteurs est un moteur, est un ballast. Au rythme des enthousiasmes et des engouements, dans un écosystème polycentrique, ils créent en permanence, chacun à leur tour ou bien ensemble, des relais d’innovation et de création, des clientèles et des richesses. On citera également le bénéfice de la durée que peuvent calmement revendiquer Dom Pérignon, Louis Vuitton, Guerlain et tant d’autres qui sont ancrés dans le temps long. Enfin la présence du Groupe LVMH sur tous les continents préserve les sociétés qui le composent des crises géographiques ou des accidents géopolitiques, leur permettant de s’appuyer tantôt sur la reprise américaine, tantôt sur la toujours exceptionnelle croissance chinoise, sur la vigueur des clientèles russes ou brésiliennes, la force de la Corée ou la fidélité du Japon, le miracle émirati ou la diaspora indienne.
KF : Quelle est la place des "high streets" parisiennes dans la compétition mondiale et la capitale française joue-t-elle un rôle particulier dans la stratégie de LVMH ?
M-A. J. : La géographie du luxe est, en effet, une géographie mondiale. Montaigne rime avec Madison ou Omotesando. Saint-Honoré avec Bond Street. Saint-Germain-des-Prés avec la Piazza di Spagna ou le Miami Design District. Vendôme avec Rodeo Drive ou la Via Napoleone. Les Champs-Élysées avec la 5ème Avenue ou Ginza. C’est une compétition à l’échelle du globe et dans cette course trois éléments sont à prendre en considération pour évaluer le rôle de Paris. Le premier est sa dimension culturelle et historique. Le luxe a besoin de racines, d’un mythe fondateur, d’une personnalisation. Il lui faut un créateur, une naissance et un lieu. C’est son ADN, sa légitimité, sa crédibilité. En murmurant « Christian Dior/1947/Avenue Montaigne », on a déjà tout dit. Les marques ont un territoire et c’est la planète. Elles ont un terroir, comme le meilleur des vins, et c’est souvent la capitale. Paris où Chaumet s’installe en 1780. Paris où Guerlain devient le parfumeur de l’impératrice en 1853. Paris où Vuitton dépose le brevet du monogramme en 1895. La capitale est l’écrin de bien des noms illustres, Givenchy, Moynat, Céline, Fred, comme Florence l’est pour Pucci ou Rome pour Fendi. Le luxe et Paris sont donc indissociables. Mais, deuxième remarque, ce lien est parfois beaucoup plus terre-à-terre. La réputation d’une ville et la notoriété d’une marque sont consubstantielles. La première est le cadre ou l’inspiration de la seconde. La seconde nourrit et fait briller la première. Touristes et clients y sont sensibles. On achètera plutôt un cuir espagnol à Madrid, une eau de toilette anglaise à Londres, un vêtement italien à Milan. Entre une capitale et les marques qui sont ses ambassadrices, il est donc important que se forgent des partenariats qui ont, parfois, des ramifications lointaines, mais essentielles : accueil, sécurité, propreté, service public, accessibilité. Enfin, troisième point, il existe un contexte économique et social qu’on aurait tort de négliger. Il faut que chacun lutte à armes égales et la question du travail de soirée, à condition qu’il soit compensé, du travail du dimanche dans des zones définies dans la concertation, est une question que la plupart des grandes villes du globe, y compris en Europe, ont réglée.
Certains de nos visiteurs ne restent que 24 heures dans notre pays. D’autres par goûts ou par habitudes privilégient certaines heures pour pratiquer l’art du shopping. On n’imagine pas l’effet désastreux, bien au-delà du sort particulier de telle ou telle société, que peuvent avoir sur eux des portes closes, un rideau tiré, une lumière éteinte.
Le but en immobilier d’entreprise ou commercial n’est pas de s’étendre, mais de cibler, donc de choisir.
KF : Après l’avenue Montaigne, l’avenue des Champs-Élysées ou la rue du Faubourg Saint‑Honoré, LVMH a été particulièrement actif ces dernières années place Vendôme, rue Saint‑Honoré et rue de Sèvres, avant de partir à l’assaut de nouveaux quartiers tels que le Marais. La conquête de Paris n’est-elle donc toujours pas achevée ? Comment les différentes marques d’un groupe tel que LVMH abordent-elles ou se répartissent-elles les rues parisiennes ?
M-A. J. : Il y a en effet des répartitions quasi thématiques. Elles se font presque naturellement.
À l’avenue Montaigne, l’univers de la Haute Couture. La joaillerie et les montres ne peuvent ignorer la rue de la Paix ou la Place Vendôme. Les différences de chalandise peuvent jouer. Sur les Champs-Élysées, la clientèle internationale et les touristes venus des pays émergents qui veulent arpenter la « plus belle avenue du monde ». Sur Montaigne, la proximité des palaces et des grands hôtels donne le ton. À Saint-Germain une clientèle qui vient chercher les dernières traces de l’existentialisme, du jazz et des caves. À Saint‑Honoré, des Américains, des Européens, des Japonais connaissant davantage Paris. Conquête n’est donc pas le bon terme. Le but en immobilier d’entreprise ou commercial n’est pas de s’étendre, mais de cibler, donc de choisir. Le sujet d’actualité, c’est une fois encore la définition des zones touristiques internationales qui permettront, dans celles qui sont retenues, aux boutiques d’ouvrir le dimanche... Une cartographie administrative peut-elle aller à l’encontre de la réalité du commerce ? Ce ne serait pas souhaitable. Personne ne veut d’ailleurs cela.
KF : LVMH n’est pas le seul groupe à s’intéresser aux "high streets" parisiennes. La compétition est même très rude, favorisant une flambée des prix et des loyers. Ce phénomène ne vous inquiète‑t‑il pas ? La rentabilité de ces investissements et l’attractivité de ces belles adresses sont-elles durables dans ces conditions?
M-A. J. : Elles sont évidemment durables et heureusement compte tenu des prix. Dans 100 ans l’avenue Montaigne existera toujours. La place Vendôme et la rue Saint-Honoré également. Si les marques se battent entre elles, pour reprendre votre analyse, ce qui n’est pas un drame, ces batailles s’inscrivent dans la durée. Les baux sont de long terme. Les acquisitions de murs ne sont pas rares. Plus que de la spéculation, il y a dans ces opérations des investissements raisonnables, lucides, avisés.
Vers un commerce humainement connecté : Cloud Atlas
Gare, la Louve entre dans Paris ! Oh, pas l’animal sauvage ni la lointaine fille de celle qui avait allaité Romulus et Remus, les fondateurs de Rome. Non, celle-ci vient tout droit de Brooklyn, New York. Une Louve avec un L majuscule.
La Louve ? C’est le nom d’un magasin d’un genre nouveau, qui ouvrira à l’automne prochain dans le 18ème arrondissement. Attention, pas à Montmartre ou aux Abbesses, mais à la Goutte d’Or. C’est dans le 18ème encore populaire que Tom Boothe et Brian Horihan, deux gastronomes américains et parisiens d’adoption depuis 10 ans, ont imaginé créer un supermarché coopératif, collaboratif, qualitatif et affectif. Deux doux rêveurs en quête d’utopie et de bonnes œuvres, direz-vous ? Pas forcément. Ils ont réussi une campagne de crowdfunding lancée sur KissKissBankBank en se fondant sur le modèle de Park Slope Food Coop, le plus grand supermarché coopératif des États-Unis, qui compte 16 000 membres et dispose d’une surface de vente de 1 000 m² dans Brooklyn.
Le principe de la Louve, c’est de réduire les frais de personnel de 75%. Les quelques salariés se font aider pour le fonctionnement du magasin par la myriade des clients membres de la coopérative, qui s’investissent en disponibilité à hauteur de trois heures toutes les quatre semaines. Ils passeront tour à tour à la caisse, au stock, à l’administration ou au nettoyage.
Les économies ainsi réalisées permettent de pratiquer des marges faibles qui se traduisent par des prix très abordables sur des produits de haute qualité. Du bio, du terroir, de l’artisanal, du saisonnier et de la diversité, bref du haut de gamme promis en rayon et correctement rémunéré aux producteurs. Parce que la Louve, émanant de la cité et ouverte sur elle, sera forcément citoyenne.
Tout ce qu’il faut pour faire d’une corvée (les courses alimentaires), un moment de plaisir et de fierté. Un rendez-vous avec soi-même et un moment d’épanouissement au travers d’un consumérisme revisité. Des courses qu’on ne délègue pas à Internet ! Une expérience qui relève un peu du repas familial, où chacun participe à mettre la table et à desservir.
La Louve, c’est bien sûr un spécimen branché et forcément un peu bobo qui en énervera certains. Un spécimen qui ne pourra pas non plus être démultiplié à l’infini. Cette louve ci ne créera peut-être pas la nouvelle Rome. Il est néanmoins évident qu’elle pointe beaucoup des enjeux qui s’ouvrent au commerce et sans doute bien des pistes offertes pour y répondre.
Le projet de la Louve, c’est en effet l’archétype du magasin connecté. Pas seulement connecté à des technologies, à des outils ou au web, mais connecté à ses clients. Au point d’en faire des membres.
Le point de vente physique a souffert de l’émergence et de la montée en puissance du e-commerce. Beaucoup d’enseignes se sont adaptées en mariant les deux modèles, transformant les boutiques en vitrines destinées à générer du chiffre d’affaires en ligne. Mais cette « showroomisation » des magasins n’est pas viable partout ni pour tous. Pour ces exclus, le défi c’est justement de réinventer la carte, l’atlas des connections, des liens et des sentiments pour leur permettre de se soustraire à la concurrence imparable de l’ordinateur et du smartphone, qui donnent les clés du commerce au consommateur, où il veut, quand il veut et comme il veut.
Multiplier les outils technologiques, les données ou le « traquage » du consommateur n’est pas suffisant. Ils sont des aides, des pistes à explorer. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que les outils ne font rien d’autre que ce que nous en faisons. Ils peuvent permettre, par exemple, de dégager du temps au personnel de vente et de le redéployer sur l’accueil, le sourire, la considération ou l’écoute. Un des b.a.-ba du commerce, trop souvent oublié. Ils peuvent donc permettre de comprendre le client pour l’accompagner ou l’amener à la découverte. Plus globalement, il leur faut toutefois également un sens, une intention. Une intention qui réside dans la création d’un lien non-marchand, condition sine qua non du maintien du lien marchand avec le client. Juan-Manuel Torralbo, fondateur de l’agence « Le Bon Mix ! » allait dans ce sens en déclarant récemment, à propos des centres commerciaux en difficulté : « C’est aux lieux d’être fidèles à leur région, et non l’inverse. Il faut inventer une stratégie de reconquête sociale en répondant aussi aux aspirations non marchandes de l’individu ». [11]
Les boutiques n’échapperont pas à ce qui est vrai pour les centres commerciaux. Elles sont appelées à devenir connectées et inclusives, avec des clients partenaires et non seulement consommateurs. C’est sans doute à cette condition que l’on pourra assister à un renouveau du commerce de proximité. À la Goutte d’Or, comme ailleurs.
Alors au fait, pourquoi la Louve ? Parce que ce nom évoque, selon Tom Boothe et Brian Horihan, l’instinct protecteur, indépendant et maternel. Tiens, tiens, si ça n’est pas une intention et du lien…
[11] LSA, 13 novembre 2014
La Louve ? C’est le nom d’un magasin d’un genre nouveau, qui ouvrira à l’automne prochain dans le 18ème arrondissement. Attention, pas à Montmartre ou aux Abbesses, mais à la Goutte d’Or. C’est dans le 18ème encore populaire que Tom Boothe et Brian Horihan, deux gastronomes américains et parisiens d’adoption depuis 10 ans, ont imaginé créer un supermarché coopératif, collaboratif, qualitatif et affectif. Deux doux rêveurs en quête d’utopie et de bonnes œuvres, direz-vous ? Pas forcément. Ils ont réussi une campagne de crowdfunding lancée sur KissKissBankBank en se fondant sur le modèle de Park Slope Food Coop, le plus grand supermarché coopératif des États-Unis, qui compte 16 000 membres et dispose d’une surface de vente de 1 000 m² dans Brooklyn.
Le principe de la Louve, c’est de réduire les frais de personnel de 75%. Les quelques salariés se font aider pour le fonctionnement du magasin par la myriade des clients membres de la coopérative, qui s’investissent en disponibilité à hauteur de trois heures toutes les quatre semaines. Ils passeront tour à tour à la caisse, au stock, à l’administration ou au nettoyage.
Les économies ainsi réalisées permettent de pratiquer des marges faibles qui se traduisent par des prix très abordables sur des produits de haute qualité. Du bio, du terroir, de l’artisanal, du saisonnier et de la diversité, bref du haut de gamme promis en rayon et correctement rémunéré aux producteurs. Parce que la Louve, émanant de la cité et ouverte sur elle, sera forcément citoyenne.
Tout ce qu’il faut pour faire d’une corvée (les courses alimentaires), un moment de plaisir et de fierté. Un rendez-vous avec soi-même et un moment d’épanouissement au travers d’un consumérisme revisité. Des courses qu’on ne délègue pas à Internet ! Une expérience qui relève un peu du repas familial, où chacun participe à mettre la table et à desservir.
Le défi du commerce de proximité et la condition de son renouveau, c’est de réinventer l’atlas des connections, des liens et des sentiments.
La Louve, c’est bien sûr un spécimen branché et forcément un peu bobo qui en énervera certains. Un spécimen qui ne pourra pas non plus être démultiplié à l’infini. Cette louve ci ne créera peut-être pas la nouvelle Rome. Il est néanmoins évident qu’elle pointe beaucoup des enjeux qui s’ouvrent au commerce et sans doute bien des pistes offertes pour y répondre.
Le projet de la Louve, c’est en effet l’archétype du magasin connecté. Pas seulement connecté à des technologies, à des outils ou au web, mais connecté à ses clients. Au point d’en faire des membres.
Le point de vente physique a souffert de l’émergence et de la montée en puissance du e-commerce. Beaucoup d’enseignes se sont adaptées en mariant les deux modèles, transformant les boutiques en vitrines destinées à générer du chiffre d’affaires en ligne. Mais cette « showroomisation » des magasins n’est pas viable partout ni pour tous. Pour ces exclus, le défi c’est justement de réinventer la carte, l’atlas des connections, des liens et des sentiments pour leur permettre de se soustraire à la concurrence imparable de l’ordinateur et du smartphone, qui donnent les clés du commerce au consommateur, où il veut, quand il veut et comme il veut.
Multiplier les outils technologiques, les données ou le « traquage » du consommateur n’est pas suffisant. Ils sont des aides, des pistes à explorer. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que les outils ne font rien d’autre que ce que nous en faisons. Ils peuvent permettre, par exemple, de dégager du temps au personnel de vente et de le redéployer sur l’accueil, le sourire, la considération ou l’écoute. Un des b.a.-ba du commerce, trop souvent oublié. Ils peuvent donc permettre de comprendre le client pour l’accompagner ou l’amener à la découverte. Plus globalement, il leur faut toutefois également un sens, une intention. Une intention qui réside dans la création d’un lien non-marchand, condition sine qua non du maintien du lien marchand avec le client. Juan-Manuel Torralbo, fondateur de l’agence « Le Bon Mix ! » allait dans ce sens en déclarant récemment, à propos des centres commerciaux en difficulté : « C’est aux lieux d’être fidèles à leur région, et non l’inverse. Il faut inventer une stratégie de reconquête sociale en répondant aussi aux aspirations non marchandes de l’individu ». [11]
Les boutiques n’échapperont pas à ce qui est vrai pour les centres commerciaux. Elles sont appelées à devenir connectées et inclusives, avec des clients partenaires et non seulement consommateurs. C’est sans doute à cette condition que l’on pourra assister à un renouveau du commerce de proximité. À la Goutte d’Or, comme ailleurs.
Alors au fait, pourquoi la Louve ? Parce que ce nom évoque, selon Tom Boothe et Brian Horihan, l’instinct protecteur, indépendant et maternel. Tiens, tiens, si ça n’est pas une intention et du lien…
[11] LSA, 13 novembre 2014
Les grands sont à la mode : Chérie, j’ai agrandi les magasins
Paris est une ville dense. L’espace y est rare et il est cher. Contrecoup logique, la parcellisation est poussée à l’extrême. Ce qui frappe souvent le visiteur venant d’endroits où l’espace est généreux, c’est que, dans cette ville, tout est petit. Les trottoirs sont étroits, les restaurants lilliputiens, les appartements nains. Haussmann a bien un peu corrigé tout ça mais l’impression demeure.
Les commerces n’y échappent pas : la superficie moyenne d’une boutique parisienne est ainsi estimée à 65 m² [9].
65 m² de moyenne ! A peine un carré de 8 mètres sur 8 mètres… C’est dire l’exiguïté des lieux et la difficulté potentielle d’y développer certains concepts. Les emplacements offrant une surface supérieure à 1 000 m² ne seraient ainsi qu’au nombre de 300 à Paris [10].
Une des spécificités de l’année 2014 sur le marché des commerces n’en ressort que plus clairement au vu de cet environnement. 2014 a en effet été l’année des grandes cellules commerciales. Nous recensons ainsi neuf transactions de plus de 1 000 m² sur l’ensemble de l’année, soit près de 3% du nombre total d’emplacements existants sur ce segment. Lors de l’année 2013, il n’y avait eu que quatre transactions similaires.
Deux transactions ont même porté sur une surface de 10 000 m² ou les ont frôlés. Leroy Merlin reprend ainsi l’ancien magasin Surcouf de l’avenue Daumesnil, dans le 12ème arrondissement. Mais la plus médiatique et la plus emblématique de ces transactions, c’est bien sûr l’arrivée des Galeries Lafayette sur les 9 300 m² autrefois occupés par le megastore de Virgin sur les Champs‑Élysées.
Alors, feu de paille ou réveil plus durable ?
La demande des enseignes est indiscutablement là. Le phénomène est toutefois bridé par le faible nombre d’opportunités d’implantation, ce qui le condamne à rester un segment réduit à l’échelle du marché. Il est néanmoins à parier que 2015 s’inscrira dans la lignée de 2014. À une différence près : les enseignes se verront offrir des surfaces inédites, créées pour l’occasion. Parmi ces créations, il y a les espaces commerciaux proposés dans l’ancien entrepôt Macdonald, en cours de restructuration et qui constituera bientôt l’élément central d’un nouveau quartier parisien en gestation dans le 19ème arrondissement. Décathlon regarderait de près l’opportunité de s’y installer sur 5 000 m².
À proximité, les 24 000 m² de Vill’Up vont ouvrir d’ici quelques semaines au cœur de la Cité des sciences et de l’industrie. Ce nouveau pôle commercial et évènementiel est d’ores et déjà largement rempli. Mais a priori, la cellule de 3 000 m², initialement dédiée à une grande enseigne culturelle, reste à commercialiser.
Le cœur de Paris ne manquera pas d’opportunités non plus, notamment avec l’extension-rénovation du Forum des Halles.
Décidément oui, 2015 devrait confirmer le réveil des locations de grandes boutiques. Un réveil qui augure bien de la confiance qu’ont les grandes enseignes dans le potentiel et le devenir du tissu commercial parisien.
[9 ] D’après les chiffres de l’APUR, « L’évolution des commerces à Paris – Inventaire des commerces 2011 et évolutions 2007-2011 »
[10] APUR, op.cit.
Les commerces n’y échappent pas : la superficie moyenne d’une boutique parisienne est ainsi estimée à 65 m² [9].
65 m² de moyenne ! A peine un carré de 8 mètres sur 8 mètres… C’est dire l’exiguïté des lieux et la difficulté potentielle d’y développer certains concepts. Les emplacements offrant une surface supérieure à 1 000 m² ne seraient ainsi qu’au nombre de 300 à Paris [10].
Une des spécificités de l’année 2014 sur le marché des commerces n’en ressort que plus clairement au vu de cet environnement. 2014 a en effet été l’année des grandes cellules commerciales. Nous recensons ainsi neuf transactions de plus de 1 000 m² sur l’ensemble de l’année, soit près de 3% du nombre total d’emplacements existants sur ce segment. Lors de l’année 2013, il n’y avait eu que quatre transactions similaires.
En 2014, une proportion inédite de boutiques de plus de 1 000 m² a changé de mains. Ce segment connaît un réel renouveau.
Deux transactions ont même porté sur une surface de 10 000 m² ou les ont frôlés. Leroy Merlin reprend ainsi l’ancien magasin Surcouf de l’avenue Daumesnil, dans le 12ème arrondissement. Mais la plus médiatique et la plus emblématique de ces transactions, c’est bien sûr l’arrivée des Galeries Lafayette sur les 9 300 m² autrefois occupés par le megastore de Virgin sur les Champs‑Élysées.
Alors, feu de paille ou réveil plus durable ?
La demande des enseignes est indiscutablement là. Le phénomène est toutefois bridé par le faible nombre d’opportunités d’implantation, ce qui le condamne à rester un segment réduit à l’échelle du marché. Il est néanmoins à parier que 2015 s’inscrira dans la lignée de 2014. À une différence près : les enseignes se verront offrir des surfaces inédites, créées pour l’occasion. Parmi ces créations, il y a les espaces commerciaux proposés dans l’ancien entrepôt Macdonald, en cours de restructuration et qui constituera bientôt l’élément central d’un nouveau quartier parisien en gestation dans le 19ème arrondissement. Décathlon regarderait de près l’opportunité de s’y installer sur 5 000 m².
À proximité, les 24 000 m² de Vill’Up vont ouvrir d’ici quelques semaines au cœur de la Cité des sciences et de l’industrie. Ce nouveau pôle commercial et évènementiel est d’ores et déjà largement rempli. Mais a priori, la cellule de 3 000 m², initialement dédiée à une grande enseigne culturelle, reste à commercialiser.
Le cœur de Paris ne manquera pas d’opportunités non plus, notamment avec l’extension-rénovation du Forum des Halles.
Décidément oui, 2015 devrait confirmer le réveil des locations de grandes boutiques. Un réveil qui augure bien de la confiance qu’ont les grandes enseignes dans le potentiel et le devenir du tissu commercial parisien.
[9 ] D’après les chiffres de l’APUR, « L’évolution des commerces à Paris – Inventaire des commerces 2011 et évolutions 2007-2011 »
[10] APUR, op.cit.
Perspectives 1 - Conjoncture & consommation : La Belle au bois dormant peut-elle se réveiller ?
Comme 2014, l’année 2015 ne s’annonce pas révolutionnaire en matière de commerce et d’emplacements commerciaux. Les hubs numéro un parisiens ont toutes les chances de continuer à tirer profit de la mondialisation et de la montée en puissance des "wealthy people" sur la planète.L’année 2015 pourrait en revanche marquer une inflexion pour les emplacements numéro deux, écartés de la « mondialisation heureuse ». Une inflexion légère mais potentiellement positive. Raisons d’y croire et raisons de rester prudents…Le moins que l’on puisse dire, c’est que les espoirs économiques, pourtant prudents, placés en l’année 2014 ont été douchés. La déception est claire. La plupart des économistes anticipaient un mouvement de reprise modérée de la croissance, après une phase de stabilisation en 2013. Les anticipations tournaient, selon les organismes, entre +0,9 et +1% de croissance du PIB français. Les résultats définitifs de 2014 ne sont pas encore connus, mais la croissance ne devrait guère faire mieux que +0,4%. Ce sera donc, dans le meilleur des cas, à peine plus qu’en 2013. L’économie française joue à la Belle au bois dormant et ce, depuis la mi‑2011, voire la mi-2007 (la période 2010/2011 ayant à peine permis de corriger le recul de 2008/2009).
Les incertitudes sont nombreuses et conduisent à la prudence. Reste que la croissance s’annonce un peu plus favorable en 2015 que lors des années précédentes.L’héroïne du conte avait connu une nuit de 100 ans. L’économie française dormira-t-elle longtemps elle aussi, pour ce que Daniel Cohen appelle ici une décennie perdue, aspirée par le cercle vicieux de la déflation ? Ou a-t-elle des chances de se réveiller progressivement ?
Les chiffres du troisième trimestre 2014, meilleurs que prévus, pourraient donner un petit espoir. Ces différences entre prévisions et résultats effectifs témoignent toutefois d’abord de la difficulté à modéliser l’avenir économique, tant la part psychologique dans les décisions des acteurs est importante. Pour paraphraser Jean Gabin : « Maintenant je sais, je sais qu’on ne sait jamais ». Si ces chiffres du troisième trimestre montrent que l’effondrement n’est pas de circonstance, il serait néanmoins bien aventureux d’en faire les prémices d’une tendance à la hausse durable. Reste que la plupart des organismes de conjoncture anticipent une année 2015 légèrement meilleure - ou moins atone - que la précédente, avec des prévisions de croissance oscillant entre 0,7 et 1,0% pour la France. La zone euro, qui absorbe 60% des exportations françaises, devrait elle aussi retrouver un peu de peps.
Les Français épargnent au lieu de consommer. C’est le signe de leur inquiétude et de la dimension psychologique dans la léthargie de la consommation.Ces éléments laissent espérer une stabilisation progressive en matière d’emplois, de même qu’une amélioration du pouvoir d’achat disponible et du moral des consommateurs. Ce dernier point est essentiel pour le devenir des commerces, notamment lorsqu’ils sont situés en dehors des emplacements numéro un. C’est en effet la clientèle locale qui alimente leur chiffre d’affaires. Que celle-ci retrouve la confiance et l’envie de se faire plaisir en consommant plutôt que de se sécuriser en épargnant et la répercussion sera immédiate sur les magasins de proximité.
Consommation mensuelle des ménages en biens (Volumes aux prix de l'année précédente chaînés - Série CVS-CJO) - Source : INSEE
Non pas que la consommation des ménages se soit effondrée. C’est même le seul pilier de l’économie française qui résiste. Il résiste en ne bougeant pas. La consommation ne baisse pas mais elle ne monte pas non plus. Cela s’est vérifié en 2014, comme pendant les sept années qui ont précédé. Plus de huit années de stagnation de la consommation : le phénomène est inédit en France depuis la fin de la dernière guerre mondiale.
Cette stagnation n’a pas pour origine une contraction du pouvoir d’achat des ménages. Ne sont en effet principalement concernées par cette contraction que les personnes en dehors de l’emploi et en situation de précarité, soit à peu près les 10% de la population les plus pauvres. Une population en marge du système économique et qui ne compte statistiquement que peu dans les chiffres de la consommation. Ce n’est pas le cas pour les 10% les plus riches, qui est l’autre catégorie touchée par la baisse des revenus disponibles (au moins pour les quantiles les plus « modestes » de ce décile très inégalitaire de la population). En langage moins technique, nous parlons ici grosso modo de la classe moyenne supérieure, restée en dehors des mécanismes de défiscalisation ou d’exil fiscal, et qui a absorbé les trois quarts des hausses d’impôts de ces dernières années. Mais globalement, à l’échelle de la population française, et malgré un chômage élevé, les salaires ont continué de progresser (faiblement certes) et le pouvoir d’achat a profité du tassement des prix.
Les raisons du calme plat en matière de consommation sont donc davantage à chercher dans la psychologie des consommateurs. Si l’on écarte l’hypothèse de l’entrée dans une société décroissante cherchant son épanouissement en dehors de l’avoir et du consumérisme (hypothèse que rien ne corrobore, à commencer par la morosité dominante de la société française), une explication s’impose : l’inquiétude des ménages quant à l’avenir, et notamment celle des classes moyennes populaires (les quatre premiers déciles de la population), qui jouent un rôle essentiel en matière de consommation. Cette inquiétude est réelle. Elle se mesure dans la hausse du taux d’épargne des ménages, qui est monté à 15,9% du revenu brut disponible au troisième trimestre 2014. Les ménages ne consomment pas plus, mais ils accroissent leurs placements, notamment en épargne contractuelle et en assurance-vie. Ces placements de long terme sont avant tout destinés à se prémunir d’éventuels coups durs à venir.
Champions du monde de l’usage des tranquillisants, les Français poussent la logique jusque dans la finance… Pour dire leur spécificité en la matière, il suffit d’un coup d’œil sur nos voisins. Quand les Français épargnent 15,9%, les Britanniques sont passés en dessous de 6%. Seuls les Allemands font plus que nous, mais sans doute pour d’autres raisons, notamment de vieillissement de la population.
De l’argent épargné, c’est de l’argent qui n’entre pas dans les circuits du commerce. Et c’est de l’argent stérilisé s’il ne peut non plus servir à financer l’investissement, les entreprises n’étant pas en demande.
Il y a donc là un ressort psychologique dans la situation française. Le briser ne sera pas aisé. Il est néanmoins possible que la suppression de la première tranche de l’impôt sur le revenu, à compter de cette année, y contribue. En « déstressant » la population solvable la plus modeste, cette mesure peut l’inciter à reprendre le chemin des magasins. Un changement qui contribuerait alors à lever les craintes de grippage de l’économie liées à d’éventuelles anticipations baissières des prix. Des anticipations qui conduisent à reporter les décisions d’achat pour profiter, plus tard, de nouvelles réductions.
Évolution du chiffre d'affaires par mode de distribution - Indice en volume sur strates intermédiaires - Cjo cvs - Source : Banque de France - DGS
Une menace réelle pour le commerce mais qu’il ne faut pas surestimer : à la fin 2014, si l’inflation sous-jacente (excluant la part la plus volatile) était nulle, la France n’était techniquement pas en situation de déflation. La déflation est une tendance durable à la baisse du prix moyen des biens et des services. Il y a ponctuellement des déflations sectorielles, qui portent sur quelques compartiments de l’économie (à l’exemple de l’immobilier résidentiel sur certains secteurs géographiques), mais le phénomène n’est pas général et ne doit pas être confondu avec la situation de désinflation actuelle. Le rythme d’inflation baisse mais le prix moyen des biens et services ne baisse pas. Il n’y a d’ailleurs contraction ni des salaires ni de la masse monétaire – contraction qui accompagne les périodes de déflation. L’agrégat M3 [6] de la masse monétaire était ainsi en hausse, sur un rythme annuel, de 2,6% en octobre 2014 pour sa composante française [7].
Si danger il y a, il est en l’occurrence davantage dans la création de bulles spéculatives, l’argent non dépensé servant à alimenter des mécaniques auto-entretenues et artificielles dans certains compartiments (immobilier, monétaire, obligataire ou autre). Des bulles qui finissent par exploser, avec souvent de grands dégâts collatéraux. Pour remédier à leur formation, la relance des investissements de productivité, publics ou privés, est une solution. À l’image par exemple du récent plan Juncker lancé par la Commission européenne.
Il y a donc des raisons d’espérer en 2015. Pour l’économie en général, pour le commerce dans sa globalité mais aussi, et c’est plus nouveau, pour le petit commerce (hors emplacements numéro un), qui est à la peine depuis quatre ans. Par ricochet, on peut espérer une évolution favorable aux emplacements numéro deux, cible principale du petit commerce indépendant. Mais de là à croire au miracle d’un retournement complet, il y a un pas que nous ne franchirons pas.
Ces évolutions ne concerneront qu’à la marge les emplacements numéro un qui, nous l’avons vu, fonctionnent à plein avec l’économie monde et sont marqués par une montée en gamme de leurs enseignes. Ils ne souffrent pas, au moins à Paris, de la morosité française. Au contraire, ils profitent de l’apparition de classes supérieures dans de nombreux pays – classes qui se mettent à voyager et à consommer lors de leurs voyages. Outre les pays émergents, l’activité de ces emplacements est dynamisée par l’enrichissement global des populations les plus aisées. Un document de travail de l’OCDE [8]montrait récemment qu’il était considérable à l’échelle des 34 pays de l’organisation. Si les revenus des 10% de la population les plus riches représentent désormais 9,5 fois le revenu des 10% les plus pauvres (jusqu’à 16 fois aux États-Unis, 27 fois au Mexique et 30 fois au Chili), le ratio n’était que de 7 dans les années 1980. Les plus pauvres ne sont pas forcément plus pauvres qu’avant, mais ils se sont moins enrichis que ceux situés à l’autre bout du spectre social.
C’est la prospérité grandissante des populations aisées qui fait le bonheur des emplacements numéro un parisiens. Géographiquement en France, ils sont l’adresse du monde entier. Et il n’y a aucune raison d’attendre un coup de théâtre qui changerait cet état de fait en 2015.
[6] L’agrégat M3 regroupe le total des pièces et billets en circulation, les dépôts bancaires à vue (comptes courants), les dépôts à court et long terme ainsi que les OPCVM monétaires.
[7] Banque de France
[8] Federico Cingano, « Tendances de l’inégalité des revenus et son impact sur la croissance », OCDE, 9 décembre 2014
02 Prix : L’Opéra de quat’(mille) sous
Les Champs-Élysées n’ont pas battu de nouveau record de prix en 2014. Mais ça s’est bousculé derrière…2014 s’est inscrite dans la continuité de 2013 en matière de localisation des succès commerciaux. Il en va de même pour les prix et leur évolution.
Très recherchés, les emplacements numéro un s’arrachent toujours à prix d’or. Bien sûr, à la différence de 2013, l’année 2014 apparaît moins flamboyante ou moins folle. Il faut dire que le marché parisien avait fait très fort en brisant un véritable tabou. La barre des 20 000 € HT/HC du m² avait en effet été franchie pour la première fois de l’histoire parisienne. Les Champs-Élysées, la plus chère des artères de la capitale française, atteignaient ainsi des valeurs dignes de Causeway Bay à Hong Kong, véritable Rolls du commerce mondial.
Pas de nouveau record absolu en 2014. Pas de nouveau tabou brisé. Il n’y a pas eu sur les Champs-Élysées de transactions à plus de 20 000 € de loyer. Mais ce n’est pas pour autant dire que le marché aurait été saisi par la prudence ou le pessimisme. Non, c’est simplement que les transactions sont rares, par manque d’opportunités, sur cet emplacement si recherché. Il est donc à parier que ces valeurs se confirmeront à la première occasion.
S’il n’y a pas eu de nouveau coup de tonnerre dans le ciel parisien, les tendances préalables se poursuivent, à commencer par l’inflation des prix sur les emplacements numéro un.
La rue Saint-Honoré en fournit un bon exemple. Elle n’en finit pas d’enfoncer ses propres records, avec cette fois-ci une transaction à plus de 11 300 €. La valeur la plus élevée était encore de 10 000 € en 2013 et de 8 000 € un an plus tôt… Plus de 40% d’augmentation en deux ans : c’est dire le changement d’échelle qui bouleverse le commerce parisien. On reste bien sûr loin du niveau des Champs-Élysées mais, pour la première fois, la rue Saint-Honoré s’affiche plus chère que certaines sections du Faubourg Saint-Honoré. Ce dernier reste évidemment - pour l’instant - inatteignable dans sa section comprise entre la rue Royale et la rue d’Anjou, avec des valeurs qui peuvent dépasser les 12 000 €, mais c’est un glissement très significatif. Pas une révolution donc, mais plutôt une révélation de la tectonique des rues commerçantes et de leur appréciation.
Car il suffit que la machine à transactions se mette en marche pour que les loyers s’emballent très vite. Le boulevard Haussmann, qui avait connu une année 2013 plutôt calme, s’est réveillé en 2014. Une des transactions enregistrées a été réalisée sur la base d’un loyer de 9 000 € en zone A. Une autre devrait se concrétiser à 8 600 €. On parle là d’une augmentation de plus de 60% par rapport aux valeurs enregistrées l’année précédente. Le boulevard Haussmann s’aligne en cela, avec un peu de retard, sur les standards de prix des autres emplacements numéro un de Paris.
Évolution des valeurs locatives en zone A sur la partie ouest de la rue Saint-Honoré et l'avenue des Champs-Élysées - Source : Knight Frank
Ailleurs, la conjoncture morose pèse forcément sur les prix. Même la raréfaction des transactions sur les emplacements numéro deux ne suffit plus à masquer la baisse globale des valeurs : pour la première fois depuis 2010, le loyer moyen des surfaces commerciales dans Paris a singulièrement reculé tout au long de l’année 2014. Il est ainsi tombé à 1 261 € au deuxième semestre 2014, contre 1 382 € un an plus tôt, soit un recul de 9%.
Le loyer moyen baisse tandis que les valeurs sur les emplacements les plus recherchés flambent : c’est dire si les écarts sont impressionnants et si le changement d’univers peut être brutal d’un quartier à l’autre. Le commerce parisien, c’est Jean qui rit et Jean qui pleure. Comme si Paris s’était donné à Janus, le dieu romain des commencements et des fins, des choix, des clés et des portes : le Janus bifrons, avec ses deux visages.
Selon que vous serez du sérail ou pas, les jugements de valeur vous rendront riche ou misérable…
Évolution du loyer moyen sur Paris intra-muros - Source : Argus de l'Enseigne
Et ailleurs ? Quand les autres quartiers font relâche
En dehors des emplacements numéro un, l’ambiance change du tout au tout. Là, pas de compétition effrénée entre enseignes pour s’offrir une vitrine. On n’est plus dans l’allegro crescendo. La morosité résume au contraire la musique du moment.
Il suffit parfois de quelques centaines de mètres pour changer d’univers commercial.
Si le Marais pétille et sable le champagne au rythme des inaugurations de boutiques, le phénomène reste circonscrit au secteur le plus touristique, principalement compris entre les Archives nationales, l’Hôtel de ville et le Centre Pompidou.
Dans le Haut Marais, aussi branché et bobo qu’il soit, mais plus confidentiel, la vie commerciale est beaucoup plus morne. Les retards du projet de Jeune Rue et les questionnements qu’il suscite en témoignent. La Jeune Rue, c’était au départ 36 restaurants et commerces, essentiellement dédiés à l’artisanat de bouche, et tous mis en scène par des designers de talent. Il s’agissait de créer, rue du Vertbois et rue Volta, un hub du goût et du bon goût, une ambassade du style et des meilleurs produits. Un projet à 30 millions d’euros, qui peine à boucler son budget. Pour l’instant, deux restaurants seulement sont là : Ibaji, un coréen réputé, et Anahi, voué à la cuisine argentine. Ils sont en passe d’être rejoints par une boucherie ainsi que par une pâtisserie, Le Tourbillon de Yann Brys, meilleur ouvrier de France. Un tourbillon qui risque toutefois d’être un peu court pour permettre à la Jeune Rue d’atteindre rapidement la masse critique qui lui serait nécessaire pour devenir un lieu de destination. Comme le reconnaissait le promoteur du projet : « Oui, on a vu trop gros. Mais le projet avait une folie due à l’emballement général qu’il suscitait. (…) C’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. » [4] Pas impossible mais oui, difficile et lent.
Et vérité du Vertbois est largement partagée. Il y a bien sûr dans Paris quelques annonces porteuses d’espoir en dehors des emplacements numéro un. Décathlon s’intéresserait de près à une cellule de 5 000 m² dans l’ancien entrepôt Macdonald (19ème arrondissement). Burger King poursuit son développement et s’installe avenue du Général Leclerc (14ème arrondissement). Mais globalement, à Paris comme dans la plupart des villes françaises, dès lors qu’on ne se situe pas sur un emplacement numéro un, le rythme des ouvertures de boutiques ralentit. Quitte à presque s’arrêter parfois. Rallentando con dolore.
C’est que la consommation des ménages français flanche. Dans son dernier baromètre, Procos fait ainsi ressortir un repli de l’activité des commerces en pied d’immeuble de -1,3% sur les dix premiers mois de 2014 et de -0,8% pour les boutiques situées en galeries commerciales de centre-ville. [5]
Même s’il reste difficile à quantifier dans les rues, le phénomène de la vacance s’étend et s’installe. Le temps de commercialisation des boutiques s’étire. Dans ce triste tableau, Paris a pourtant de la chance : elle est en grande partie épargnée par la vacance structurelle, qui reste ici conjoncturelle. On finit par trouver des utilisateurs. Ce n’est pas le cas partout ailleurs en périphérie ou, plus loin, dans les villes régionales.
Le sujet de la vacance est tabou. Fin 2014, le petit monde des centres commerciaux a été saisi d’une polémique qui est édifiante à ce sujet. Elle opposait Procos, qui représente les enseignes, et le CNCC, émanation des propriétaires de centres commerciaux. Procos estimait la vacance (y compris celle des cellules commercialisées mais en attente d’occupation) à 7,6% dans les centres commerciaux français, en hausse de 50% par rapport à la fin 2012. Et l’organisme soulignait un pic à 11% de vacance dans les centres commerciaux ouverts après l’an 2000. Des chiffres fermement démentis par le CNCC, qui n’utilise pas la même méthodologie et assure que la vacance est moins élevée dans les centres commerciaux que dans les autres formes de commerces.
Reste que personne ne conteste le plus important : l’évolution. Et l’évolution parait clairement à la hausse de la vacance dans de nombreux centres, galeries et rues, qui peinent aujourd’hui à attirer le chaland et, surtout, à le faire consommer. Pour sortir de cette ornière, il va falloir attendre. Attendre que l’économie française reparte de l’avant. Attendre que le consommateur retrouve confiance et envie. Et, bien sûr, comprendre ce que seront ses envies.
[4] Cédric Naudon, cité dans M le Magazine, 27 novembre 2014
[5] Procos (Fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé), panel octobre 2014, réalisé auprès de 50 enseignes dans 50 pôles de référence, situés dans 15 agglomérations
Il suffit parfois de quelques centaines de mètres pour changer d’univers commercial.
Si le Marais pétille et sable le champagne au rythme des inaugurations de boutiques, le phénomène reste circonscrit au secteur le plus touristique, principalement compris entre les Archives nationales, l’Hôtel de ville et le Centre Pompidou.
Dans le Haut Marais, aussi branché et bobo qu’il soit, mais plus confidentiel, la vie commerciale est beaucoup plus morne. Les retards du projet de Jeune Rue et les questionnements qu’il suscite en témoignent. La Jeune Rue, c’était au départ 36 restaurants et commerces, essentiellement dédiés à l’artisanat de bouche, et tous mis en scène par des designers de talent. Il s’agissait de créer, rue du Vertbois et rue Volta, un hub du goût et du bon goût, une ambassade du style et des meilleurs produits. Un projet à 30 millions d’euros, qui peine à boucler son budget. Pour l’instant, deux restaurants seulement sont là : Ibaji, un coréen réputé, et Anahi, voué à la cuisine argentine. Ils sont en passe d’être rejoints par une boucherie ainsi que par une pâtisserie, Le Tourbillon de Yann Brys, meilleur ouvrier de France. Un tourbillon qui risque toutefois d’être un peu court pour permettre à la Jeune Rue d’atteindre rapidement la masse critique qui lui serait nécessaire pour devenir un lieu de destination. Comme le reconnaissait le promoteur du projet : « Oui, on a vu trop gros. Mais le projet avait une folie due à l’emballement général qu’il suscitait. (…) C’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais. » [4] Pas impossible mais oui, difficile et lent.
Et vérité du Vertbois est largement partagée. Il y a bien sûr dans Paris quelques annonces porteuses d’espoir en dehors des emplacements numéro un. Décathlon s’intéresserait de près à une cellule de 5 000 m² dans l’ancien entrepôt Macdonald (19ème arrondissement). Burger King poursuit son développement et s’installe avenue du Général Leclerc (14ème arrondissement). Mais globalement, à Paris comme dans la plupart des villes françaises, dès lors qu’on ne se situe pas sur un emplacement numéro un, le rythme des ouvertures de boutiques ralentit. Quitte à presque s’arrêter parfois. Rallentando con dolore.
C’est que la consommation des ménages français flanche. Dans son dernier baromètre, Procos fait ainsi ressortir un repli de l’activité des commerces en pied d’immeuble de -1,3% sur les dix premiers mois de 2014 et de -0,8% pour les boutiques situées en galeries commerciales de centre-ville. [5]
Même s’il reste difficile à quantifier dans les rues, le phénomène de la vacance s’étend et s’installe. Le temps de commercialisation des boutiques s’étire. Dans ce triste tableau, Paris a pourtant de la chance : elle est en grande partie épargnée par la vacance structurelle, qui reste ici conjoncturelle. On finit par trouver des utilisateurs. Ce n’est pas le cas partout ailleurs en périphérie ou, plus loin, dans les villes régionales.
Le sujet de la vacance est tabou. Fin 2014, le petit monde des centres commerciaux a été saisi d’une polémique qui est édifiante à ce sujet. Elle opposait Procos, qui représente les enseignes, et le CNCC, émanation des propriétaires de centres commerciaux. Procos estimait la vacance (y compris celle des cellules commercialisées mais en attente d’occupation) à 7,6% dans les centres commerciaux français, en hausse de 50% par rapport à la fin 2012. Et l’organisme soulignait un pic à 11% de vacance dans les centres commerciaux ouverts après l’an 2000. Des chiffres fermement démentis par le CNCC, qui n’utilise pas la même méthodologie et assure que la vacance est moins élevée dans les centres commerciaux que dans les autres formes de commerces.
Reste que personne ne conteste le plus important : l’évolution. Et l’évolution parait clairement à la hausse de la vacance dans de nombreux centres, galeries et rues, qui peinent aujourd’hui à attirer le chaland et, surtout, à le faire consommer. Pour sortir de cette ornière, il va falloir attendre. Attendre que l’économie française reparte de l’avant. Attendre que le consommateur retrouve confiance et envie. Et, bien sûr, comprendre ce que seront ses envies.
[4] Cédric Naudon, cité dans M le Magazine, 27 novembre 2014
[5] Procos (Fédération pour l’urbanisme et le développement du commerce spécialisé), panel octobre 2014, réalisé auprès de 50 enseignes dans 50 pôles de référence, situés dans 15 agglomérations
Subscribe to:
Posts (Atom)